Jean-François Dietrich
"J’ai débuté, il y a très longtemps, quand j’étais jeune, par le théâtre. Mes pièces L’impasse, Le cinquième train, Esquisses ont été montées par la Compagnie du Verseau ou la Compagnie du chien qui fume, et 5.905 inchs par la Cie Artemis.
Ensuite, j’ai travaillé beaucoup, j’ai eu des enfants, deux, et j’ai travaillé, beaucoup.
J’ai repris l’écriture depuis un peu plus de dix ans. J’ai suivi des ateliers, des stages. Tout comme le musicien fait ses gammes, il est essentiel de confronter son écriture, d’en explorer les méandres et de lui donner de la liberté. Et surtout, j’aime cette ambiance de travail à la fois individuel et partagé de l’écriture en atelier, se confronter à la lecture et s’enrichir de l’écriture des autres.
Pour pouvoir ensuite se lancer seul dans l’écriture, par hasard et nécessité."

Bibliographie
"Un roman comme un marathon, des Nouvelles, comme des sprints, écrire, regarder le monde à hauteur d’Homme, regarder les hommes, les femmes, les enfants et le reste, la nature un peu, les voitures qui passent et le temps qui se dépasse.
Écrire, ça ne sert à rien, juste à rester vivant."
- Roman
Une Terrasse au soleil
Éditions Les Chantuseries, 2019
Prix national de littérature du Lion’s club 2020
Un roman qui évoque l’exil et l’attachement, les errances et l’enracinement. Isabella est née au Chili, ses parents sont réfugiés en France. Elle connait des amours, des désamours, fait un enfant et des erreurs. Elle arrive par hasard dans une petite bourgade de Vendée. Une librairie-café comme une dernière escale, peut-être.
Pour que tout commence, tout recommence.

Extrait :
"La petite fille s’amuse. Elle joue avec les assiettes, les couverts en plastique. C’est nouveau pour elle. Cela ressemble à une dînette. La petite fille s’amuse. Elle ne sait pas qu’elle quitte définitivement sa maison, ses amies, son pays. Elle ne sait pas qu’elle ne reverra plus sa grand-mère et l’oncle Juan. Ce qui compte pour elle, c’est ce plateau repas qui ressemble à une dînette et ces nuages que l’on voit à travers le hublot. Elle trouve que cela ressemble à des oreillers ou à du coton, ces banalités que l’on se dit quand on est dans un avion.
Pour elle, c’est nouveau, c’est la première fois. Elle ne sait pas qu’elle oubliera sa grand-mère, ses amies, son pays. Elle ne se souviendra de rien. Elle ne se souviendra plus du soleil, des rues, et même de sa maison. Elle oubliera sachambre avec le lit aux montants de bois sculptés, la porte qui grinçait et que sa mère laissait entrouverte le soir quand elle s’endormait, la cuisine où elle aimait manger avec grand-mère qui ne s’asseyait jamais. Elle oubliera Marietta, Faustina et les autres copines d’école, l’école et la maîtresse. Elle oubliera ce qui est avant ce jour, ce 5 mai 1974. Elle s’en voudra plus tard d’avoir tout oublié, mais elle n’y peut rien, ce n’est pas de sa faute, c’est ce qu’elle se dira ensuite, sans y croire.
Son enfance est perdue, elle ne le sait pas. Elle s’amuse avec la dînette en plastique qui n’est pas une dînette. Ce n’est qu’un plateau-repas dans un avion. Vol entre Chili et Europe. Elle ne reverra plus grand-mère qui ne s’asseyait jamais dans la cuisine pour manger. Grand-mère regardait l’enfant en souriant. Elle lui disait :
— Isabella, mange, Petite. Tu seras grande et belle.
Isabella riait. Elle disait :
— Pourquoi tu ne t’assois pas, grand-mère ?
La grand-mère répondait qu’il n’était plus temps de s’asseoir, que bientôt elle s’allongerait. Isabella ne comprenait pas. Elle mangeait son pain et la confiture. Elle riait."
- Recueils de Nouvelles
En Corps présent
Editions Ex-Aequo 2018
Des nouvelles qui vont chercher là où le hasard les mène, dans des photos, des migrations, des mémoires défaillantes, des corps allongés et des faits divers.
Des nouvelles de l’incertitude, du rire, ou du sourire plutôt, et de l’ironie aussi, celle que l’on peut voir dans nos miroirs. On regarde les horloges et on se dit que la vie est ce qu’elle est.
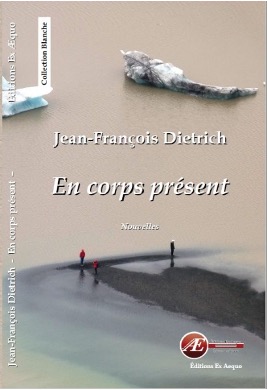
Extrait de la nouvelle Exil (s) ; Meurs et pars
(Vaclav est un émigré tchèque arrivé aux Etats Unis dans les années 20)
"Après l’océan.
Après avoir clapoté dans l’océan en hurlant que j’étais un homme libre, américain, l’avenir devant moi et la fortune à portée de main, j’ai eu faim.
Et j’ai appris, qu’ici, quand tu as faim, si tu n’as pas d’argent, tu vas avoir très faim, très, très faim.
Ma grand-mère Balouchka laissait toujours un morceau de pain dans la huche. « Si quelqu’un a besoin » elle disait. Quand le pain était sec, elle le donnait aux lapins « Faut pas perdre ». La soupe de toute façon, y’en avait toujours en train de chauffer. Un type n’aurait jamais eu faim en passant devant chez nous.
Ce que j’ai pu avoir faim à San Francisco, à Los Angeles, à San Diego, à Phoenix. Et les odeurs de saucisse avec cette sauce sucrée écœurante.
« Non, non, moutarde pour moi ! » Je dis toujours ça avant que le type n’empoigne les bouteilles rouges de cette sauce improbable. En Tchécoslovaquie, je disais : « Donnez-moi des machkens ! » Bon dieu ! Ces saucisses grillées avec une bière, une vraie bière, une qui vous dit son nom quand elle descend dans la gorge, pas la pisse d’âne d’ici, la bière de chez Kovac avec de la mousse qui vous remonte dans les narines et l’âme.
Je n’ai plus eu faim quand j’ai commencé à faire mon boulot, des fenêtres, des portes, des maisons. C’est partout pareil. J’ai su dire « tenon-mortaise » avant de dire baignoire et draps. Chez Grand-mère, on savait dire « baignoire » mais on n’en avait jamais vue. Ici, il suffit d’aller aux bains douches. Tu donnes une pièce et te voilà comme un roi à barboter dans ta casserole humaine. Tu peux même tremper à côté d’un autre type et discuter de chevaux et de filles ou bien de filles et de chevaux. On parle rarement d’autre chose. Tu causes à n’importe qui ici. Il va te laisser crever de faim mais te causer, ça il peut ! Chez moi, avant… C’est marrant, je ne dis plus « chez moi », je dis « chez moi, avant » comme un môme qui a quitté la maison de ses parents. Avant, chez moi, on causait pas trop, on regardait, on y allait doucement mais on buvait, on mangeait ensemble d’abord. Ici, le type te parle de sa femme, sa mère, sa maitresse en attendant le tramway et le lendemain, il te reconnait pas.
Y’a pas de trahison ici parce que les promesses ne valent rien. Tu te crois berné, mais non, en fait, on t’a juste raconté une belle histoire et toi, tu y a cru."
Les Effacements
Editions Ex-Aequo
Ce qui s’oublie, ce qui se tait, ce qui disparait, l’ineffable… Et peut-être de nouveaux départs, une chance, un hasard.
Les Effacements part de Berlin, file sur la côte vendéenne et finit le long d’un canal.
Explorer le quotidien, les accidents de vie, avec une douce ironie sans juger. Un frôlement des finitudes et des renaissances.

Extrait de la nouvelle Les deux font la paire
"Pour se ressembler, ça on pouvait dire qu’elles se ressemblaient. Dans le quotidien, personne n’était capable de les distinguer. On les appelait « les jumelles ». Quand on n’en voyait qu’une, on l’appelait « la jumelle ». Les autres gamins de la rue parvenaient parfois à tomber juste, mais c’était surtout dû au hasard. À l’école, elles étaient dans la même classe et bien sûr, elles passaient leur temps à se faire passer l’une pour l’autre. Les enseignants avaient renoncé à les disputer pour cela, car de toute façon, ils ne savaient pas laquelle ils étaient en train de punir. Quand elles étaient en primaire, le directeur de l’école avait voulu les séparer de classe. Il avait expliqué aux parents que c’était mieux pour leur développement, la construction de leur identité et tout quoi, enfin, tout ce qu’on peut lire dans les bouquins de psychologie écrits par ceux qui n’ont pas de gosses parce que quand on a des gosses, on sait bien qu’on ne peut rien écrire de sûr là-dessus. Les gosses, c’est pire que le loto parce que tu ne gagnes jamais vraiment et que si tu gagnes, ben le gros lot, il se fait la malle quand il est majeur.
Enfin, le directeur, il avait voulu faire les choses comme dans les livres, mais quand les jumelles ont vu à la rentrée qu’elles n’étaient pas dans la même classe, elles se sont assises au milieu de la cour, elles n’ont plus bougé, elles n’ont plus sorti un mot. On a dû les porter en classe. À midi, elles n’ont rien mangé. Il a fallu de nouveau les porter en classe. Ce sont les parents qui sont venus les chercher le soir, les ramener le lendemain matin. Pendant toute une semaine, les jumelles n’ont voulu ni marcher, ni parler, ni manger. Le vendredi soir, les parents ont dit au directeur que sans doute les bouquins avaient raison pour les autres enfants, mais pas pour leurs jumelles. Le directeur avait hésité et comme il ne voulait pas d’ennui, tout de même, il a dit que c’était un cas particulier et il a remis les jumelles dans la même classe dès le lundi suivant. À la seconde où elles ont été de nouveau ensemble, elles se sont remises à parler et à jouer comme si de rien n’était, comme si rien ne s’était passé. C’est sûr, elles étaient un cas particulier."
Retour à la page "Les auteurs des ateliers et des stages d'écriture"